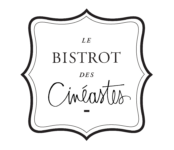Crédit photo : François Margolin
« J’ai connu Souleymane Cissé durant le Festival de Cannes 1987. J’avais écrit un article sur Yeelen (La Lumière, en bambara) qui est pour moi son chef d’œuvre, avant même qu’il n’obtienne le Prix du Jury. Il avait beaucoup aimé, et nous sommes rapidement devenus très amis. Il avait pris l’habitude d’habiter chez moi lorsqu’il venait à Paris, et il débarquait souvent sans prévenir, passant un coup de fil du café d’en bas : « Allo ? Tu es là ? Je peux monter ? » et il restait un jour ou plusieurs semaines.
Je suis allé chez lui à de nombreuses reprises à Bamako. Je connais de près tous ses nombreux enfants -il en a tellement que souvent il ne se rappelait plus du nombre exact, il faut dire qu’il avait eu plusieurs femmes- et mes enfants ont découvert le Mali grâce à lui. Je connaissais l’Afrique depuis longtemps mais aller à Tombouctou avec Souleymane était un vrai plaisir.
Il était profondément malien mais il connaissait la France et les arcanes de la société française sans doute mieux que la plupart des cinéastes français. Il était aussi à l’aise en costume sombre qu’en boubou. Aussi à l’aise dans un RER de lointaine banlieue que sur le tapis rouge de Cannes où il avait ses habitudes.
Il avait l’air d’un jeune homme malgré ses quatre-vingt-quatre ans et sautait de rendez-vous en rendez-vous quand il était à Paris, d’avion en avion et de Festival en Festival le reste du temps. Il ne semblait pas vieillir.
C’est pour cela que sa mort, soudaine, hier, m’a stupéfait. Il est mort dans son sommeil, au cours de la sieste qu’il avait entreprise juste après avoir donné une conférence de presse pour protester contre le manque de diffusion des films africains dans l’Afrique francophone. Il devait partir demain à Ouagadougou où il aurait présidé le jury de ce qui est encore le plus grand festival de cinéma d’Afrique, le FESPACO. Un FESPACO dont il avait gagné à deux reprises, pour les films Baara (Le Travail) en 1978 et Finye (Le Vent) en 1982, la récompense suprême : l’Etalon d’Or de Yennenga.
Souleymane avait fait ses études à l’école de cinéma de Moscou, le VGIK, dans les années 60 et il avait eu pour professeur un des maîtres du cinéma soviétique, Mark Donskoy. Il en gardait un profond attachement à la culture russe et à la langue qu’il parlait couramment. Il faisait appel, souvent, à des opérateurs russes, qu’il aimait plonger dans une autre lumière, celle de l’Afrique.
Il avait été marqué par ce séjour en Union Soviétique au point de commencer sa carrière par un cinéma « social », aussi bien avec Den Muso (La Jeune fille) qu’avec Baaraet Finye, mais, chaque fois, il mettait les pieds dans le plat : dénonçant le rejet par sa famille, pour cause de « traditions », d’une jeune fille violée, ou se rangeant du côté des étudiants en révolte contre le régime militaire d’alors, ce qui lui valut un séjour en prison.
Avec Yeelen, il replongeait au cœur des mystères de l’Afrique, de sa magie et de ses traditions, souvent masquées par deux siècles de colonisation.
Mais l’autre aspect de la vie de Souleymane, auquel il consacra ses quinze ou vingt dernières années -tout en continuant à faire des films, mais avec plus de difficulté, faute de trouver des financements- fut la création de l’UCECAO, l’association des cinéastes d’Afrique de l’Ouest, à laquelle il tenait tant. Il organisa de nombreux rendez-vous au Mali, souvent en partenariat avec l’ARP, auxquels participèrent Costa Gavras, Jean-Jacques Annaud, Michel Gomez (l’ex-délégué général) ou moi-même. C’était toujours étonnant : je me rappelle ainsi d’une sorte de « congrès » à cinq heures de (mauvaises) pistes de Bamako, dans son village natal, au bord du fleuve Niger, où il avait réussi à convaincre François Bayrou, qui n’était pas encore Premier ministre, de venir.
Car Souleymane Cissé avait une force de persuasion très forte et il suscitait le respect de tous, à travers le monde, aussi bien en Asie qu’à New York, où Martin Scorsese le vénérait. Il avait reçu le Carrosse d’Or, de la Quinzaine des Cinéastes, en 2023, pour l’ensemble de son œuvre.
Souleymane Cissé n’était pas un cinéaste africain. Il était tout simplement un grand cinéaste. »
François Margolin, pour les Cinéastes de L’ARP